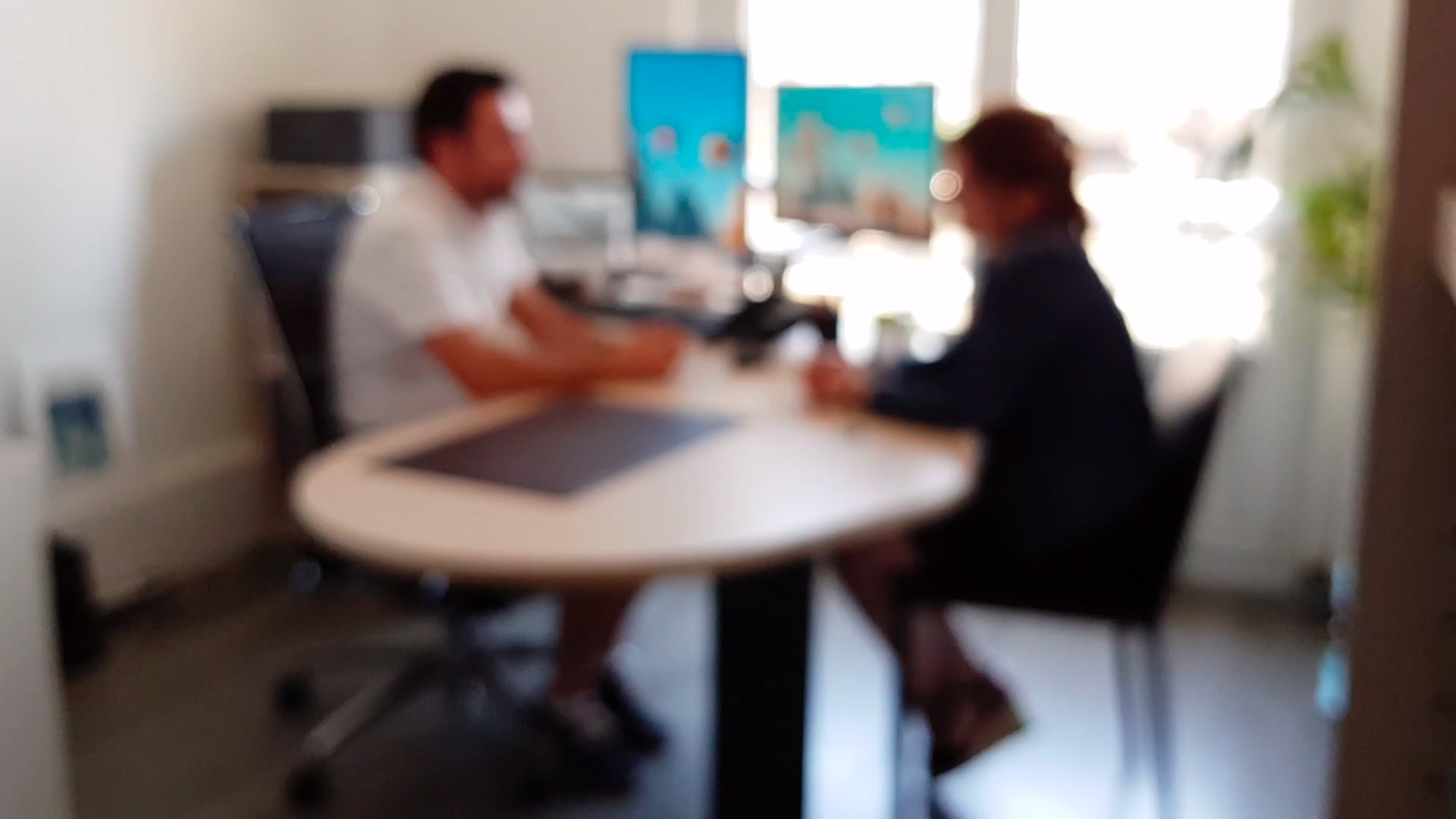Résumé : Le salarié perçoit les mêmes indemnités, qu’il signe une rupture conventionnelle ou qu’il fasse l’objet d’un licenciement (sauf s’il s’agit d’un licenciement pour faute grave) ; et il est traité de la même manière au titre du chômage.
A cette « petite » exception près que si l’indemnité de rupture conventionnelle est supérieure au minimum applicable, un délai de carence spécifique sera appliqué et le paiement des allocations de retour à l’emploi sera retardé.
Or dans certains cas il perd des droits importants, qui lui auraient été accordés s’il avait été licencié. Par ailleurs, le salarié peut contester son licenciement devant le conseil de prud’hommes et ainsi obtenir des dommages-intérêts en cas de licenciement abusif ; ce qui n’est pas possible en cas de conclusion d’une rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle, créée par la loi du 25 juin 2008, a incontestablement bouleversé les mentalités et les pratiques en matière de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. L’accord des deux parties (le salarié et l’employeur) est au cœur du mécanisme. Dans l’esprit du législateur, le contrat de travail qui a été conclu d’un commun accord devait pouvoir être rompu d’un commun accord, de manière sécurisée mais avec un formalisme réduit, sous le contrôle de l’inspection du travail.
La pratique est toute autre. Bien souvent c’est l’employeur qui prend l’initiative de proposer la rupture conventionnelle, parce qu’il souhaite rompre le contrat de travail, mais qu’il sait qu’il n’a pas de motif pour pouvoir prononcer un licenciement. Voire même, c’est parfois le médecin du travail qui invite le salarié à la demander auprès de son employeur, pour éviter de prononcer une inaptitude (alors qu’il en a l’obligation dès lors qu’il constate médicalement cette inaptitude). Et bien souvent le salarié accepte, satisfait d’éviter une pression quotidienne et de pouvoir bénéficier de l’indemnisation chômage. Malheureusement le salarié ignore bien souvent à quels droits il renonce en acceptant la rupture conventionnelle, droits qui peuvent être particulièrement importants.
L’objet de cet article est de les rappeler.
Il faut tout d’abord insister sur le fait que la raison pour laquelle la rupture conventionnelle a été conclue ne peut plus être discutée par la suite.
Lorsqu’il est licencié, le salarié peut toujours contester devant le Conseil de prud’hommes le licenciement dont il a fait l’objet, pour demander qu’il soit jugé abusif ; car le juge doit analyser la décision prise par l’employeur. Le salarié peut même parfois contester sa démission et estimer qu’elle doit produire les mêmes effets qu’un licenciement abusif.
Mais lorsqu’il signe la rupture conventionnelle, il s’interdit en principe de la contester en critiquant les raisons pour lesquelles elle a été signée. Dès lors que les deux parties ont signé cet acte, le juge n’a pas à en apprécier la raison. Le code du travail permet certes à chacune des parties de contester la rupture conventionnelle dans un délai de douze mois, lorsqu’elle estime que son consentement a été vicié, qu’elle a été abusée par l’autre partie. La jurisprudence de la Cour de cassation est cependant extrêmement sévère pour admettre un tel cas de figure. Ainsi par exemple, un climat conflictuel, une procédure disciplinaire enclenchée avant la proposition et la signature d’une rupture conventionnelle sont indifférentes.
La Cour de cassation estime manifestement que le formalisme prévu par la loi en matière de rupture conventionnelle est suffisant pour protéger le salarié : notamment, le code du travail prévoit un entretien préalable obligatoire, un délai pour se rétracter s’il le souhaite, et l’inspecteur du travail doit homologuer la convention pour rendre la rupture définitive et efficace. Malheureusement on s’aperçoit en pratique que bien souvent l’entretien préalable n’a jamais lieu (l’on mentionne le jour de signature de la rupture la date de l’entretien qui n’a en réalité jamais eu lieu), que le salarié n’a aucun délai pour se renseigner, et que le contrôle de l’inspecteur du travail se limite très généralement au montant de l’indemnité prévue et aux respects des délais, faute de temps. Quant à la possibilité de se rétracter, on imagine difficilement comment un salarié qui accepte la rupture conventionnelle sous la pression de son employeur pourrait sérieusement l’envisager, car cela signifierait un retour sur son poste de travail et de possibles représailles.
Par ailleurs, la loi accorde des avantages très importants au salarié, lorsqu’il fait l’objet de certains types de licenciement. Par exemple, le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est protégé : l’article L 1226-9 du Code du travail interdit qu’il fasse l’objet d’un licenciement, sauf en cas de faute grave ou « d’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie », et ce tant que dure la suspension du contrat de travail (c’est-à-dire tant que le salarié n’a pas fait l’objet d’une ou de deux visites de reprise devant le médecin du travail). Le licenciement prononcé malgré cette interdiction est nul, et le salarié peut alors demander une indemnisation importante devant le Conseil de prud’hommes. En outre, que l’arrêt de travail fasse suite à un accident du travail ou qu’il s’agisse d’une maladie « simple », une procédure spécifique de licenciement s’applique lorsque l’arrêt de travail a duré au moins 30 jours : le salarié doit être examiné par le médecin du travail dans les 8 jours de la fin de l’arrêt, pour que celui-ci apprécie ses capacités à reprendre ou non son emploi. Si cette reprise est impossible le médecin du travail rend un avis d’inaptitude. L’employeur doit alors chercher un poste de reclassement ; s’il n’y en a pas, il doit licencier le salarié, qui percevra donc son indemnité de licenciement et qui pourra solliciter l’indemnisation chômage. S’il ne licencie pas, l’employeur a l’obligation de reprendre le paiement des salaires après un mois, même si le salarié ne peut pas travailler. Si l’arrêt de travail était d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle), son indemnité de licenciement sera doublée, et il percevra en outre le salaire correspondant au préavis qu’il aurait dû exécuter.
Mais ces règles protectrices s’effacent totalement lorsqu’une rupture conventionnelle est conclue et que le salarié n’a pas été licencié. La Cour de cassation juge que « la rupture conventionnelle peut valablement être conclue au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle » (arrêt du 30 septembre 2014 n° 13-16297). Ce qui signifie, en pratique, que le salarié quitte alors son emploi avec la seule indemnité de rupture conventionnelle, dont le montant est au minimum égal à l’indemnité de licenciement… alors qu’il aurait pu obtenir une indemnité doublée de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, et qu’il aurait pu contester son licenciement devant le juge (si par exemple un poste de travail disponible et correspondant à ses capacités ne lui avait pas été proposé).
La même chose se retrouve dans le licenciement pour motif économique. Alors que dans un tel cas la loi protège le salarié, en lui offrant un maintien de salaire bien plus important par Pôle emploi, la rupture conventionnelle va lui faire bénéficier de l’indemnisation Assédic de droit commun.
Le constat est donc simple : dans de nombreuses hypothèses, il n’y a pas d’intérêt pour le salarié à accepter la rupture conventionnelle. En cas d’acceptation, il percevra bien souvent l’indemnité minimale à laquelle il aura droit, du même montant que l’indemnité de licenciement. Il ne bénéficiera pas du préavis, et il ne pourra pas contester la rupture du contrat devant le juge prud’homal. Insistons sur ce point : le salarié est traité exactement de la même manière par Pôle emploi (sous la réserve évoquée ci-dessus), et perçoit les mêmes indemnités, qu’il signe une rupture conventionnelle ou qu’il fasse l’objet d’un licenciement (sauf s’il s’agit d’un licenciement pour faute grave). Le montant de son indemnité de rupture est le même (indemnité de licenciement ou indemnité de rupture conventionnelle), et ses droits au chômage sont identiques. La seule différence tient au fait que le salarié peut contester son licenciement devant le conseil de prud’hommes et ainsi obtenir des dommages-intérêts en cas de licenciement abusif.
Enfin, insistons sur le fait qu’il est impossible de conclure une rupture conventionnelle sans le consentement et l’accord du salarié : celui-ci doit obligatoirement être d’accord et signer le document. Le salarié doit donc être pleinement conscient des avantages dont il se prive ; et dans ces conditions, il est parfaitement fondé à négocier les conditions de son départ. L’indemnité qui doit lui être versée correspond, au minimum, à l’indemnité de licenciement qu’il aurait perçu s’il avait été licencié ; mais rien n’interdit évidemment que ce montant soit plus élevé. Et si les deux parties doivent être d’accord sur le principe même de la rupture du contrat de travail, elles doivent l’être également sur les conditions de cette rupture.